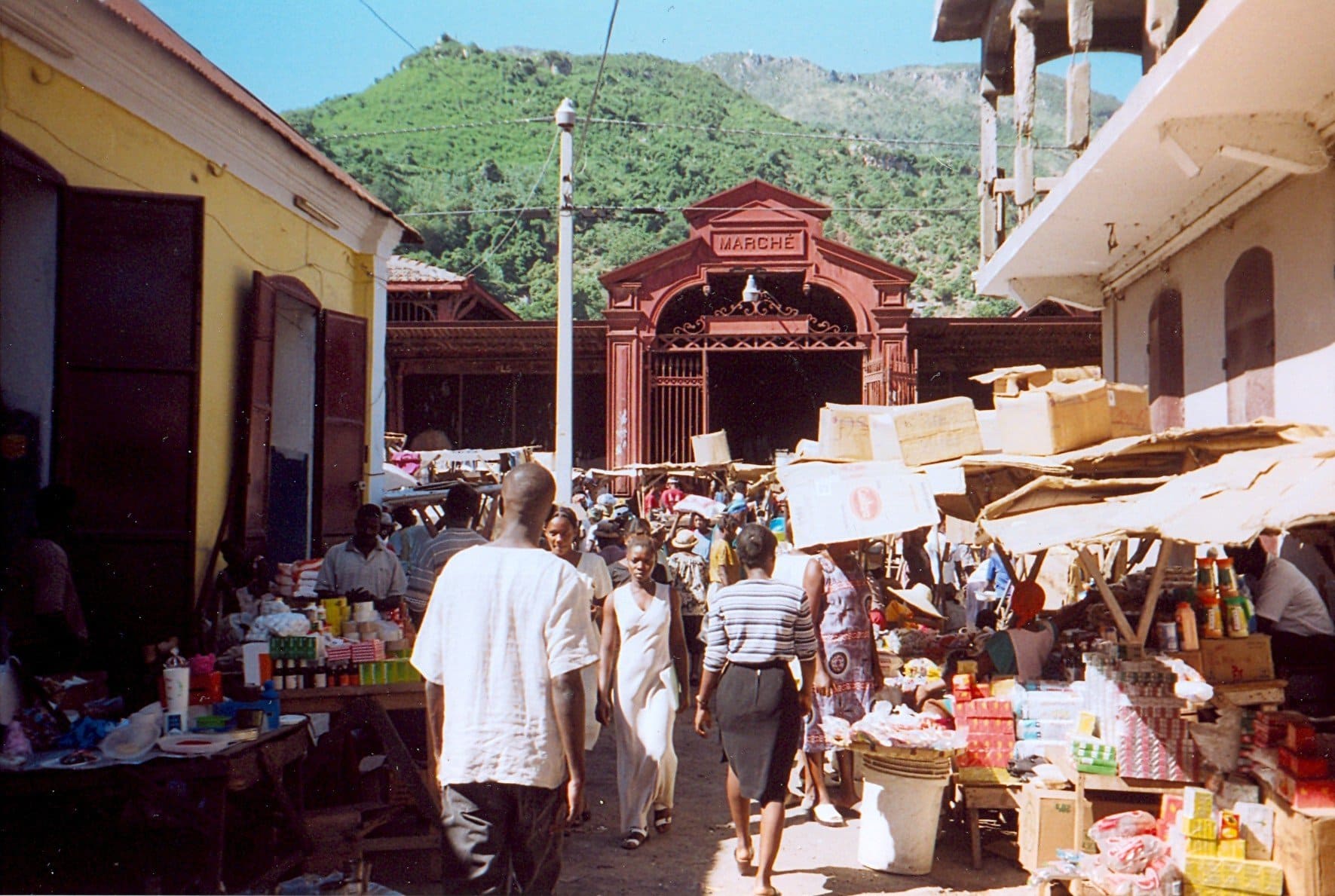Dans son « document d’information » publié en octobre 2025, la Banque de la République d’Haïti (BRH) met en garde les acteurs économiques haïtiens contre les dangers de la dollarisation du pays. Ce document de 16 pages, disponible sur le site de la banque centrale, retrace l’histoire chaotique de la dépréciation de la gourde face au dollar américain au cours des 30 à 40 dernières années. Il propose également une analyse de la situation actuelle et des pistes pour éviter une catastrophe économique.
Les faits et la mise en garde
Sur 20 boutiques localisées à Pétion-ville, 17 d’entre elles affichent leur prix en dollars (soit 85 %), a fait savoir la BRH dans le document, d’après une enquête menée en 2020. Par ailleurs, appuie-t-elle, les ventes de véhicules, de terrains ou d’immeubles sont strictement fixées en dollars américains par les commerçants, concessionnaires ou rentiers. Une attitude prudente face à la volatilité du taux de change et à la dégringolade de la gourde, observe la banque. Ce qu’elle [dans une note de bas de page] juge toutefois illégal et pointe du doigt l’absence de cadres institutionnels suffisamment contraignants. Le dollar n’ayant pas cours légal en Haïti.
La double circulation monétaire : un danger pour l’économie
La double circulation monétaire est le fait, dans l’économie d’un pays, d’utiliser deux devises différentes, à savoir une monnaie locale et une étrangère. Elle peut être induite par divers facteurs d’ordre économique : un secteur informel important, une forte intégration économique avec un autre pays, entre autres. Ou une dépendance marquée aux transferts privés. [Ce qui est sans conteste le cas d’Haïti.] C’est un indice flagrant de l’état de l’économie du pays et de sa production. Qui n’est pas aussi sans conséquences.
L’une des choses observables dans cet état de fait est la «dollarisation partielle» du marché haïtien ; c’est-à-dire le fait que nombre de transactions s’effectuent en cette devise. « Dans le cas d’Haïti, le degré élevé de dollarisation s’impose comme un facteur structurel limitant l’efficacité de la politique monétaire et la stabilité macroéconomique », se plaint la première banque du pays en conclusion de son analyse. Cette accentuation de la dollarisation dans l’économie se pose en freins quant aux objectifs des décisions de politiques monétaires.
Double circulation monétaire en Haïti : une croissance en exposition exponentielle
Le 18 janvier 1990, un décret de l’État haïtien a autorisé les banques commerciales à recevoir des dépôts en dollars ÉU. Cette décision visait à corriger les distorsions du marché de change et à en assurer un meilleur contrôle. Elle a mis fin à une longue période, de 1919 à 1990, durant laquelle le taux fixe de parité de cinq gourdes pour un dollar américain a été appliqué, avec de légères variations entre 1982 et 1991. Malheureusement, cette décision n’a pas tenu ses promesses.
En effet, « Cette décision prise dans un contexte marqué par une inflation élevée a conforté la préférence des agents économiques pour cette devise, ce qui a conséquemment encouragé la dollarisation.», révèle le document. Les entreprises en ont profité pour afficher des taux de change supérieurs à ceux du marché. Rendant de ce fait inefficaces les mesures institutionnelles et gouvernementales pour limiter ou réglementer cette utilisation. Ce qui ne facilite pas non plus la longue période d’instabilité politique allant de 1986 à aujourd’hui. Ni les anticipations négatives du public sur l’instabilité de la gourde le poussant vers le dollar comme valeur d’échange.
« Depuis l’adoption du régime de change flexible, les dépôts en dollars ÉU dans le système bancaire ont considérablement augmenté au détriment de ceux libellés en gourdes. De 11,3 millions de dollars ÉU en septembre 1991, ils sont passés à 1,06 milliard de dollars ÉU en septembre 2008 pour s’établir à 2,63 milliards de dollars ÉU en septembre 2024. », lit-on dans le dossier. Un des nombreux indicateurs permettant de rendre compte du niveau de la dollarisation du pays. Ce qui démontre par là la préférence croissante des agents économiques pour la devise américaine dans les transactions locales et la fragilisation constante de la gourde par rapport à celle-ci.
D’autres indicateurs comme le poids des transferts sans contreparties, qui s’est accru jusqu’à représenter 17% dans le PIB de 2024 ; la proportion des transactions commerciales ou parfois des salaires libellés en dollars ; ne sont pas des statistiques négligeables.
Causes /conséquences et risques pour l’économie haïtienne
Dans son document d’information, la BRH fixe les causes de cette dollarisation de l’économie haïtienne et en tire les répercussions, tout en prévenant les risques. L’économie haïtienne, sur les trente dernières années, évolue, selon le document, dans un environnement où les déséquilibres macroéconomiques ont des répercussions négatives subséquentes sur la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Ce qui accentue la concurrence entre les deux devises au détriment de la gourde et favorise l’utilisation du dollar dans les transactions. « Or, une telle situation peut fragiliser le système financier, alimenter la dépréciation de la gourde et aussi constituer une contrainte à la transmission des impulsions monétaires de la Banque centrale. », soutient le document. C’est ce qui justifie l’importance de telles informations dans le contexte actuel pour la banque centrale.
D’un autre côté, l’instabilité socio-politique, la progression rapide de l’inflation et/ou du taux de change. L’intégration commerciale et financière et/ou les transactions internationales élevées des acteurs économiques, les montants significatifs de transferts sans contrepartie reçus. La législation/la politique monétaire/la confiance dans la monnaie nationale sont autant de facteurs déterminants dans ce processus de dollarisation. Et qui constituent des éléments de fracture dans cette crise monétaire.
Les mesures prises par la Banque de la République d’Haïti ; comme l’émission des obligations BRH en 2015, la facturation des cartes de crédit exclusivement en gourdes ou l’interdiction des prêts à la consommation en dollars ÉU, malgré une certaine limitation, se sont avérées insuffisantes pour contrer le phénomène.
Les solutions possibles
Sans prendre en compte son implication dans le processus de dédollarisation du pays, la BRH avance que toutes les politiques en ce sens devront être analysées rigoureusement pour ne pas créer davantage de distorsions. Et aussi de lancer des signaux clairs de discipline fiscale et monétaire durables pour restaurer la confiance dans la monnaie locale. Les exemples des pays comme le Vietnam ou le Pérou qui ont su maintenir la dollarisation de leurs économies par des mesures fortes, sont à suivre. Dans le cas d’Haïti, « il convient aussi de prendre en compte les facteurs psychologiques », ces derniers étant liés aux conditions sécuritaires et à l’instabilité sociopolitique qui alimentent la méfiance envers la monnaie nationale, conclut la BRH.