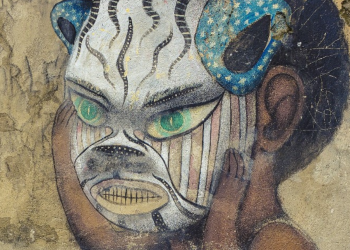Petit-Goâve est l’une des plus anciennes cités d’Haïti. Elle a traversé les siècles avec une histoire riche et mouvementée. Anciennement le siège du Conseil Souverain de la colonie de Saint-Domingue et un temps considérée comme une capitale de facto de l’ancienne colonie française, elle est aujourd’hui un pôle socio-économique essentiel de la Région des Palmes et des Nippes. Cependant, cette ville côtière, vibrante de culture et notamment célèbre pour son fameux Dous Makòs, traverse actuellement l’une des périodes les plus éprouvantes de son histoire récente. La population de La Digue et de ses environs est durement frappée par des crues incessantes qui ont semé la désolation pendant le passage du cyclone Melissa.
Les dégâts sont immenses et considérables. Pour la seule zone de La Digue, située dans la 11e section communale, le cyclone Melissa a causé la perte de vies et de biens, en particulier dans la nuit du 28 au 29 octobre.


Le bilan provisoire communiqué par le Dr. Fred Jasmin, Directeur de l’Hôpital Notre Dame, fait état d’environ 12 morts confirmés, parmi lesquels figurent tragiquement 9 enfants et 3 adultes. D’autres sources locales parlent d’une vingtaine de morts. Les disparus n’ont pu être évalués en raison de la persistance des pluies. Ces pertes se concentrent sur une superficie d’environ 25 à 30 km², touchant La Digue, Fond-Fabre, Provence et Borne Soldat. Des familles entières sont endeuillées, et plus de 1000 familles sinistrées sont estimées. Des maisons ont été emportées par la force impitoyable de la rivière. À cela s’ajoutent d’innombrables pertes de bétail, privant les paysans de leurs moyens de subsistance. Et pourtant, il ne s’agissait que des effets indirects du cyclone.

Cette réalité met en évidence l’extrême fragilité du territoire et le manque criant d’infrastructures adaptées pour faire face à de telles catastrophes. Les images de bébés, d’enfants et de mères emportés par les eaux resteront longtemps gravées dans les mémoires, témoignant de la vulnérabilité et du désarroi de ses habitants.
La situation, déjà précaire, s’est encore détériorée avec l’arrivée de nombreux déplacés fuyant l’insécurité qui ravage Port-au-Prince. Cet afflux de populations fragilisées a accentué la pression sur les ressources locales, compliquant davantage la gestion de la crise et amplifiant l’urgence humanitaire. Les autorités, dépassées par l’ampleur inattendue du désastre, peinent à organiser une réponse rapide et efficace.


La saison cyclonique, phénomène naturel récurrent, ne peut être évitée. Mais elle peut être anticipée. Le problème est certes national, mais il ne peut être abordé dans sa globalité immédiate compte tenu des limitations en termes de ressources financières. Il pourrait être abordé de manière progressive, par un plan évolutif prenant d’abord en compte les zones d’Haïti à plus haut risque. C’est pourquoi il devient urgent que la structure de l’État dédiée au secours d’urgence, en l’occurrence la Direction de la Protection Civile, mette en place, en synergie avec les autres ministères, un programme national de prévention et de résilience, fondé sur une vision durable du territoire.
Ce plan devrait comprendre, notamment :
• La réduction drastique de la coupe anarchique des arbres et la promotion du reboisement massif ;
• L’arrêt immédiat et la réglementation stricte de l’exploitation anarchique des carrières en amont et sur les berges de la rivière ;
• La protection des bassins versants et la restauration des sols ;
• Le curage régulier des berges afin d’assurer le bon écoulement des eaux, de maintenir la capacité hydraulique des cours d’eau et de prévenir les risques d’envasement ou d’obstruction ;
• Le renforcement de la présence et de l’autorité de l’État sur le terrain ;
• Le déplacement planifié et sécurisé des populations vivant dans les zones à haut risque ;
• La construction d’abris adéquats et structurés pour l’accueil des familles identifiées comme étant à haut risque ;
• Ainsi que la préparation et la mise à disposition, avant chaque saison cyclonique, des aides humanitaires nécessaires.
Ces dispositions paraissent lourdes pour une économie en lambeaux et sous le poids de l’insécurité. Cependant, l’adoption de mesures progressives et évolutives marquerait un effort significatif et nécessaire pour le soulagement de la douleur des populations.
Ce drame doit servir de rappel : face aux dérèglements climatiques et à la dégradation de l’environnement, la prévention n’est plus une option, mais une obligation. La Digue, aujourd’hui meurtrie, nous appelle à une prise de conscience collective et à une action concertée, avant que d’autres vies ne soient emportées.
Hugo Allen
Entrepreneur culturel et citoyen Petit-Goâvien qui prête ses services à la communauté. Opérateur culturel aussi, Hugo a mis sur pieds pas mal d'activités culturelles dans la ville à côté des jeunes.