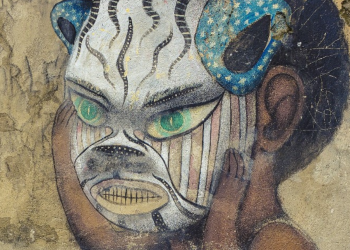Manger, ce n’est pas un luxe. Ce n’est pas un caprice. Manger, c’est vital. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant a le droit d’accéder à une nourriture sûre et digne. Pourtant, aujourd’hui, en Haïti comme ailleurs, ce droit est souvent piétiné.
La nourriture locale, celle qui pousse sous nos mains et sur nos terres, se retrouve parfois reléguée derrière ce qui vient d’ailleurs. Ce phénomène n’est pas nouveau, et il est complexe. Dans les « markets » où l’aubergine se vend deux dollars et la salade dix, on impose une hiérarchie du goût et du prix qui ignore souvent la qualité et la santé. Mais tout ce qui vient de l’extérieur n’est pas mauvais, tout ce qui est local n’est pas forcément parfait. La nuance se perd souvent dans le bruit des étiquettes et des slogans.
Ici, on achète parfois plus volontiers du lait en boîte que celui tiré par le fermier du coin. On préfère les grandes surfaces qui clament « Made in… » en lettres brillantes, et on détourne le regard de l’agriculteur qui voudrait qu’on consomme naturellement. Pourtant, ce choix n’est pas toujours idéologique : il répond aussi à des contraintes de prix, de disponibilité et de commodité. « Healthy » ou pas, l’accès à une alimentation saine reste un luxe pour beaucoup.
Pendant ce temps, des produits industrialisés, sur-stérilisés, bourrés d’OGM et d’additifs, circulent à bas prix. Les pays qui nous les vendent cultivent ailleurs le bio, l’équitable, l’authentique. Mais même ce « bio » mérite interrogation : ce qui pousse dans le sol est-il toujours pur ? Et qu’en est-il de ce qui pousse dans les politiques, les profits et les habitudes ?
La malbouffe massive qui s’étale sur notre territoire est le produit d’un long conditionnement. Les anecdotes abondent : ce petit paysan qui cultive sa terre, vend ses produits, puis achète pour sa famille des céréales ou du salami industriel. Ce choix n’est pas simple : il mêle modernité rêvée, nécessité économique et habitudes imposées. Autrement dit, ce qui est nutritif, il le vend. Et ce qui est pratique ou « moderne », il l’achète.
Ma préoccupation, loin des statistiques du MSPP et des débats techniques, c’est cette malbouffe qui flotte sur le pays comme un drapeau planté sur une terre conquise. Les nouvelles tombent chaque heure : des jeunes qui souffrent de maladies liées à l’alimentation, des corps prématurément usés. On appelle ça « manger à petit prix ».
Moi, j’y vois surtout une grande entreprise de résignation : avaler chaque jour sa part de dépendance, enveloppée dans le grand chant plastique des rivières.